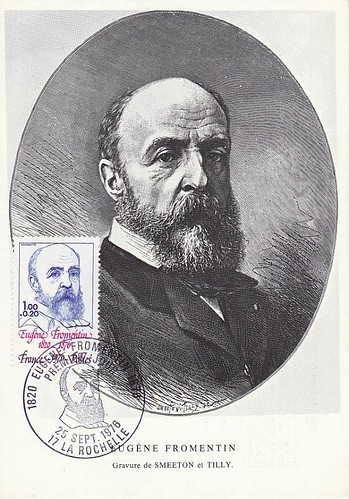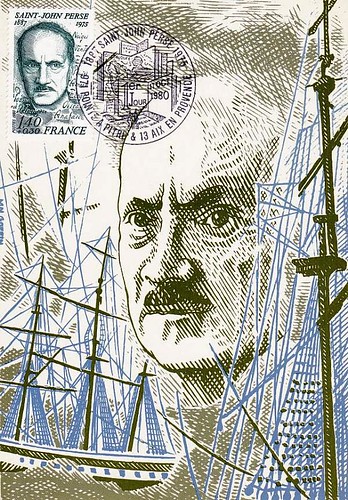1802-Alexandre Dumas-1870.
Alexandre Dumas est un écrivain français né le 24 juillet 1802 (5 thermidor an X) à Villers-Cotterêts (Aisne) et mort le 5 décembre 1870 à Puys, près de Dieppe (Seine-Maritime).
Il est le fils de Thomas Alexandre Davy de la Pailleterie, dit le général Dumas, et le père de l’écrivain Alexandre Dumas (1824-1895) dit Dumas fils, auteur en particulier de La Dame aux camélias.
Biographie
Dumas naît le 24 juillet 1802 rue de Lormet à Villers-Cotterêts de l’union de Thomas Alexandre Davy de la Pailleterie, général d’armée ayant fait une brillante carrière pendant la Révolution française, et Marie Labouret, fille de Claude Labouret, aubergiste à l’Écu d’or à Villers-Cotterêts.
« Je suis lié à Villers-Cotterets, petite ville du département de l’Aisne, située sur la route de Paris à Laon, à deux cents pas de la rue de la Noue, où mourut Demoustiers, à deux lieues de la Ferté-Milon, où naquit Racine, et à sept lieues de Château-Thierry, où naquit la Fontaine.»
L’enfant a pour marraine sa sœur, Aimée-Alexandrine Dumas (son ainée de neuf ans) et pour parrain le maréchal d’Empire Guillaume Brune.
Entre 1804 et 1806, c’est au château des Fossés, loué par son père, qu’Alexandre
Dumas a fixé ses tous premiers souvenirs : « Du plus loin qu’il me souvienne, c’est-à-dire de l’âge de trois ans, nous habitions, mon père, ma mère et moi, un petit château nommé les Fossés, situé sur les limites des départements de l’Aisne et de l’Oise, entre Haramont et Longpré. On appelait ce petit château les Fossés, sans doute parce qu’il était entouré d’immenses fossés remplis d’eau.»
On retrouve ces tous premiers souvenirs dans son œuvre : « Sur les limites du département de l’Aisne, à l’ouest de la petite ville de Villers-Cotterêts, engagées dans la lisière de cette magnifique forêt qui couvre vingt lieues carrées de terrain, ombragées par les plus beaux hêtres et les plus robustes chênes de toute la France, peut-être, s’élève le petit village d’Haramont, véritable nid perdu dans la mousse et le feuillage, et dont la rue principale conduit par une douce déclivité au château des Fossés, où se sont passées deux des premières années de mon enfance.»
Le général Dumas meurt le 26 février 1806, quatre ans après la naissance de son fils. Alexandre Dumas a pour aïeuls un marquis désargenté qui immigra en 1760 à l’île de Saint-Domingue et une esclave ou affranchie noire du nom de Marie-Cessette Dumas.
Quarteron, Dumas fut souvent en butte aux sarcasmes racistes de ses contemporains.
« Au fait, cher Maître, vous devez bien vous y connaître en nègres ?- Mais très certainement. Mon père était un mulâtre, mon grand-père était un nègre et mon arrière-grand-père était un singe. Vous voyez, Monsieur : ma famille commence où la vôtre finit. »
Il a neuf ans lorsqu’il entre au collège de l’abbé Grégoire à Villers-Cotterêts. Il y reçoit les bases de l’instruction primaire. Il y restera élève jusqu’en 1813.
À treize ans, le petit Alexandre ne sait presque rien, il a pour seule éducation ses lectures de la Bible, de récits mythologiques, de l’Histoire naturelle de Buffon, de Robinson Crusoé et des Contes des mille et une nuits. Cependant, sa calligraphie est exceptionnelle. Il est engagé comme coursier dans une étude de notaire, celle de maître Mennesson. « Il fut donc décidé que, le lundi suivant, j’entrerais chez maître Mennesson : les gens polis disaient en qualité de troisième clerc, les autres en qualité de saute-ruisseau. »
Alexandre fera la connaissance d’Adolphe de Leuven qui l’initiera à la poésie moderne. Ils auront également l’occasion d’écrire ensemble des vaudevilles.
Jusqu’en 1822, Dumas vit à Villers qu’il quitte pour Paris, pour échapper à la pauvreté et aux humiliations que sa mère et lui connaissent depuis le mort du général et plus encore depuis celle de Claude Labouret, son grand-père maternel.
Là-bas, il trouve une place de clerc de notaire et découvre la Comédie-Française. C’est le début d’une vie nouvelle pour Alexandre lorsqu’il fait la rencontre d’un grand acteur de l’époque, Talma. L’année suivante, grâce à la protection du général Foy il travaille dans les bureaux du secrétariat du duc d’Orléans et peut enfin faire venir sa mère à Paris.
Un an après, le 27 juillet 1824, c’est la naissance d’Alexandre son fils, fruit de sa liaison avec Laure Labay, couturière et sa voisine de palier place des Italiens. L’enfant est illégitime jusqu’à ce que Dumas le reconnaisse le 17 mars 1831, quelques jours après la naissance de sa fille Marie-Alexandrine (le 5 mars 1831) qu’il a eue de Belle Kreilssamer.
Cette même année, Dumas se remet au vaudeville avec de Leuven et La Chasse et l’Amour connaît un grand succès. C’est aussi la période où Dumas découvre les « Romantiques » et va beaucoup au théâtre. Il écrit son premier drame historique, Henri III et sa cour en 1828. Bien que qualifiée de « scandale en prose » (en référence à Hernani, la pièce de Victor Hugo qualifiée de « scandale en vers » à sa création), la pièce présentée à la Comédie-Française connaît un énorme succès.
C’est un auteur prolifique, avec l’aide notoire de « nègres » et en particulier d’Auguste Maquet qui a participé à la plupart de ses réalisations. Il signe des grandes fresques historiques telles Les Trois Mousquetaires ou Le Comte de Monte-Cristo en 1844. La même année, Dumas achète un terrain à Port-Marly et fait bâtir le « château de Monte-Cristo », une bâtisse de style composite, à la fois Renaissance, baroque et gothique.
En 1846, il fait construire son propre théâtre à Paris, boulevard du Temple, qu’il baptise « Théâtre-Historique ». Le théâtre est inauguré en 1847 et accueille les pièces de plusieurs auteurs européens (Shakespeare, Goethe, Calderon, Schiller) avant de faire faillite en 1850.
En 1848, il est candidat malheureux aux élections législatives qui suivent la révolution. Il soutient ensuite Louis-Eugène Cavaignac contre Louis-Napoléon Bonaparte.
Ruiné par la faillite de son théâtre, Dumas est obligé de vendre aux enchères son château qu’Honoré de Balzac admirait tant. En 1851, poursuivi par plus de 150 créanciers, Dumas doit s’exiler un temps en Belgique.
Il ne ralentit pas pour autant sa production littéraire. Fin gourmet, il est même l’auteur d’un Grand dictionnaire de cuisine.
« Alexandre Dumas partageait son temps, comme d’habitude, entre la littérature et la cuisine; lorsqu’ il ne faisait pas sauter un roman, il faisait sauter des petits oignons. »
En septembre 1870, après un accident vasculaire qui le laisse à demi paralysé, Dumas s’installe dans la villa de son fils à Puys, quartier balnéaire de Dieppe. Il y meurt le 5 décembre 1870. Sa dépouille est transférée au Panthéon de Paris le 30 novembre 2002, à l’occasion du bicentenaire de sa naissance.
Source : Wikipédia