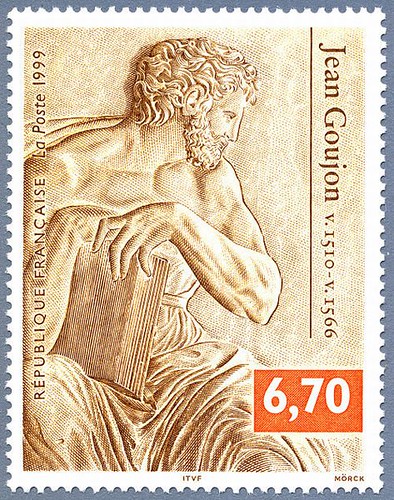Astérix “Journée du timbre 1999″
octobre 11th, 2011Astérix “Journée du timbre 1999″
On dénombre désormais des dizaines de milliers de jeunes philatélistes en France. La Poste a su séduire ce public enthousiaste et curieux, et, s’ouvre à lui en poussant les portes de son univers. Parmi les personnages qui nourrissent ses rêves et ses rires, certains n’ont fait que de brèves incursions dans l’histoire avant de retomber dans l’anonymat le plus strict.
Mais parmi l’imagerie foisonnante et parfois éphémère, un personnage attire, depuis 1961, la lumière complice des yeux des enfants et des plus grands: Astérix le Gaulois. Sorti de l’imagination exercée de deux compères, Albert Uderzo et René Goscinny, illustrateurs et scénaristes, le petit Gaulois moustachu a très rapidement atteint une notoriété insoupçonnée par ses créateurs, le hissant à la une des journaux nationaux. Sa cote de popularité allait grimpé à folle allure dans le cœur des français. Une hausse vérifiée par les 150 000 albums vendus en 1964, atteignant bien vite plus d’un million d’exemplaires dès 1967, avec une entrée sur le marché allemand.
Une naissance presque aussi cocasse qu’un épisode des futures aventures mettant en scène ce Gaulois malicieux et ses deux inséparables acolytes Obélix et Idéfix. En effet les deux créateurs décidèrent un jour de remonter, par ordre chronologique, les grandes périodes de l’histoire. Uderzo venait à peine de dépasser le paléolithique que Goscinny l’interrompit:” Vercingétorix, grand vainqueur de Gergovie” venait d’allumer dans l’esprit des scénaristes, le signal de la gloire et l’avènement d’Astérix.
Avec pour toile de fond la Gaule, les créateurs amorçaient, sans le savoir, leur destin et celui de leurs créatures. Après Astérix le Gaulois, en 1961, premier épisode du nom proposé dans le magasine “Pilote”, dans lequel les principaux protagonistes étaient déjà campés, 30 autres épisodes se sont succédés. En 1996 enfin, après des années d’absence et presque 20 ans après la disparition de Goscinny, Uderzo a publié “La galère d’Obélix”. Les volumes de la collection des aventures d’Astérix sont diffusés à plus de 280 millions d’exemplaires dans le monde entier et traduits en 77 langues. Une recette qui d’évidence a frappé les esprits: des personnages attachants doublés d’un caractère bien trempé, un scénario fondé sur des gags visuels, les jeux de mots et les dialogues référencés. Une réussite totale pour ces Gaulois, bien moins “fous que les Romains” à en croire leur popularité jamais démentie et, comme le prédisaient modestement leurs créateurs, à l’abri de toutes modes.
Elodie Baubion- Broye.
Timbre: Œuvre d’Albert Uderzo, imprimé en héliogravure. Format vertical de 26 x 36 mm vente anticipée le 6 mars 1999 à Paris et vente générale le 8 du même mois.
Source: collection philatélique de la Poste.